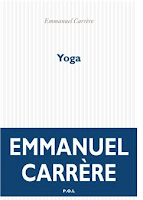Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, éd. Folio Classique, coll. XL, novembre 2020, 1264 p.
Relire, dit-elle…
Le plaisir de cette relecture relève de la joie pure. Dumas, je l’ai découvert tard. J’ai dévoré Les Trois Mousquetaires alors que je venais d’achever mes études universitaires, puis Joseph Balsamo, puis Le Comte de Monte-Cristo, en un été. L’histoire d’Edmond Dantès, je m’y suis replongée souvent, films et téléfilms, et dans le texte aussi. Disons que j’en suis à ma quatrième relecture du texte. Et chaque fois dans une édition différente.
On ne dira jamais assez l’importance du poids du livre dans nos mains, la douce douleur de la pliure du poignet sous la gravité de plus d’un millier de pages, la magie de faire défiler sous son pouce, comme pour un flip-book, ce que l’on a lu, et ce qui reste à lire. Pour les textes longs, très longs, je préfère le volume unique. J’y trouve une sensualité, une promesse. Je suis pour le temps étiré, dans l’intrigue et son traitement, et pour la dévoration, dans la lecture. Idem pour les séries : beaucoup d’épisodes avalés d’une seule traite, ou presque. J’aime les pavés. Je viens de relire Le Comte de Monte-Cristo dans l’édition Folio Classique en un seul volume, dans une collection baptisées XL, collection qui ne compte, me semble-t-il, que deux ouvrages : outre celui de Dumas, Les Misérables de mon cher Victor Hugo.
Tout le monde connaît l’intrigue du Comte de Monte-Cristo, c’est notre culture commune. Trois temps forts, d’inégale ampleur, scandent l’histoire : la promesse du bonheur, l’emprisonnement injuste et l’évasion, la vengeance. Le château d’If fait à jamais partie de notre imaginaire, de même que le trésor dans l’île. Personne n’a oublié le nom du navire sur lequel Edmond Dantès revient à Marseille – le Pharaon – ni le prénom de la jolie fiancée des Catalans – Mercedes. Ça commence à Marseille, ça se poursuit en Orient tout en ellipse, en Italie, ça bifurque en Corse, et ça prend véritablement forme à Paris, sur les Champs-Elysées et à Auteuil, où Edmond Dantès, devenu comte de Monte-Cristo, a établi son camp. Car il s’agit de mener bataille, de se venger des traitres, de ne pas faillir à la mission que l’on s’est donnée.
Le Comte de Monte-Cristo est un roman noir, désespéré. Le beau jeune homme capitaine de navire, joyeux, confiant, n’aspirant qu’au bonheur d’une vie simple auprès d’une épouse aimante devient un dieu vengeur, manipulateur, sûr de sa mission. Il détient les secrets de la médecine et du haschich, il est servi par des domestiques dévoués corps et âme, il possède une esclave, il apparaît sous différentes formes – abbé, lord… –, il est omniscient et omniprésent. Il fait mourir et ressusciter une jeune fille, il est dieu. Ce dieu-là est saturnien, sombre, dégouté par ce que la vie a fait de lui. Mais il sait où il va, il sait ce qu’il veut, et lorsque les événements le prennent de court, il réagit en homme de pleins pouvoirs. Non de pouvoirs terrestres – ceux-là, les pouvoirs terrestres, sont aux mains des traitres qu’il traque : un banquier, un procureur, un pair de France, c’est-à-dire la finance, la justice et la politique – mais de pouvoirs souterrains, occultes – la richesse donnée comme dans un conte de fée, la dissimulation, la connaissance des poisons. Et puis, à la toute fin, le dieu ayant accompli sa vengeance redevient homme, entrevoit la possibilité d’un avenir plus clair.
Je ne vais pas ici détailler l’intrigue, elle est, je l’ai dit, connue. Les noms d’Edmond Dantès, de Morrel, de Villefort, de Danglars, de Morcef et de Caderousse sont dans toutes les mémoires. On a peut-être oublié – mais je ne peux y croire – le personnage de Noirtier enfermé dans ce que l’on nomme à présent le « locked in syndrome », vieillard ne pouvant communiquer que par le regard, et le lesbianisme d’Eugénie Danglars qui, déguisée en homme, fuit avec sa maîtresse la maison paternelle où l’on veut la marier. La scène où elle coupe ses longues tresses brunes est extraordinaire de force et de justesse.
Voilà, j’ai relu Le Comte de Monte-Cristo pour la quatrième fois. Je connais les replis de ce texte, les bifurcations de cette intrigue. Mais cela ne gâche en rien la joie de la relecture. Au contraire. Je me suis réfugiée dans cette histoire lue et relue comme dans un abri douillet en ces temps compliqués de confinement.
*
NB : cette édition Folio Classique est dérivée de l’édition en Pléiade. Préface de Jean-Yves Tadié, texte établi et annoté par Gilbert Sigaud. On appréciera l’appareil critique, éclairant.