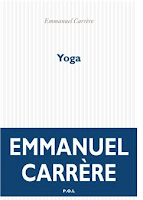Amélie Nothomb, Les Aérostats, éd. Albin Michel, 19 août 2020, 180 pages.
Comment retomber sur terre après avoir donné à entendre, à la première personne, la voix du Christ en sa Passion ? Difficile… Lors de la rentrée littéraire 2019, Amélie Nothomb avait placé la barre assez haut avec Soif – très très haut, en fait – et voilà qu’en cette fin août 2020 elle nous ramène en Belgique. Bruxelles, littérature, champagne, chocolatines, parricide et matricide, voilà les ingrédients de son nouveau roman Les Aérostats.
Ange a dix-neuf ans, elle étudie la philologie. Elle est la colocataire d’une certaine Donate qui ne supporte pas que l’on déplace ses courgettes dans le bac à légumes du réfrigérateur commun. Ange est sollicitée par le père d’un jeune homme de seize ans prénommé Pie : il s’agit que le garçon guérisse de sa dyslexie et puisse passer brillamment son bac de français, oui, on est en Belgique, mais aussi dans le cursus scolaire républicain. Pie n’a jamais lu un livre. Problème.
Le texte est construit sur des scènes dialoguées assez savoureuses, Amélie Nothomb a un savoir-faire qui n’est plus à démontrer. Le gamin vierge de lecture, au nom improbable, parvient à lire Le Rouge et le Noir, Le Bal du comte d’Orgel, La Métamorphose, et tout un tas d’autres classiques. S’en suivent des discussions littéraires déviées de façon réjouissante et pertinentes entre l’étudiante en posture professorale et le jeune homme. Discussions suivies par le père de Pie, derrière une vitre sans tain.
Les Aérostats est un roman agréablement et humoristiquement pervers. Ange sait qu’elle est sous surveillance paternelle quand son élève l’ignore. Ange ne sait pas si elle en train de tomber amoureuse de Pie, qui n’est qu’un gamin, quand elle se fait entreprendre par un de ses profs quinquagénaire, prénommé Dominique. Ange et Dominique ont en commun le caractère épicène de leur prénom, ce qui renvoie à un roman précédent d’Amélie.
Tout cela finira dans une mare de sang.
On pourrait se réjouir d’un retour nothombien à la gravité légère, aux digressions sur les vertus combinées du chocolat, des olives vertes et du champagne, à la célébration de la ville de Bruxelles. On pourrait apprécier, vraiment apprécier, la chute du roman, qui donne à la littérature tout son sens meurtrier, c’est-à-dire de dessillement, et goûter le twist final qui apparaît en quatrième de couverture : « Le jeunesse est un talent, il faut des années pour l’acquérir. »
Mais… mais, lorsque l’on choisit comme thème principal la découverte de la littérature et ses éventuels prolongements assassins, on n’a pas droit au faux-pas. Surtout si l’on prend comme héroïne une étudiante en philologie, ce qui suppose des connaissances en latin et en grec. Il se trouve qu’Ange propose à Pie de lire l’Iliade. Qu’il apprécie, en bon ado qui préfère la guerre à l’amour. Rappelons qu’à ce stade des Aérostats, le jeune Pie n’a lu que Le Rouge et le Noir, imposé par Ange. Il n’a jamais rien lu d’autre. Et donc, voilà qu’il dévore l’Iliade, et peut en parler :
« […] Les Troyens, je les apprécie, surtout Hector.
- Qu’est-ce qui vous plaît en lui ?
- Il est noble, courageux. Et il a un point commun avec moi : il est asthmatique.
- Le mot asthme n’est pas employé dans le texte.
- Non, mais la description de sa crise ne trompe pas. Je reconnais les symptômes. Et je comprends qu’il soit allergique aux Grecs !
- Quand même, ils ont quelques éléments intéressants, Ulysse par exemple.
- Ulysse ? Un sale type ! Le coup du cheval de Troie, quelle infamie !
- Timeo Danaos et dona ferentes.
- C’est ça, oui. »
(P.30)
Euh… un gamin de 16 ans qui n’a pas encore lu l’Odyssée, et encore moins l’Enéide de Virgile dont est tirée la citation latine Timeo Danaos et dona ferentes ne peut raisonnablement pas soutenir une telle conversation littérairement serrée. Il n’est nullement question, dans l’Iliade, de l’épisode du cheval de Troie. Bien sûr, nous sommes là dans l’épaisseur du trait : la conversation est invraisemblable, et le vraisemblable n’est pas l’intention romanesque première d’Amélie Nothomb. Mais, quand même… dans un roman qui brasse, entre autres thèmes, l’influence de la découverte de lecture sur un esprit jeune modelé par une étudiante sensée maîtriser son sujet, cela fait un peu tache. Et gâche l’édification romanesque.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la rentrée littéraire 2021. On y attend un Nothomb plus convaincant.