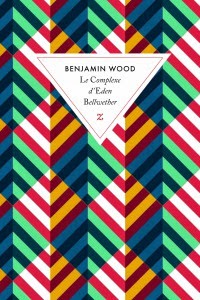Regards
croisés
Un livre, deux lectures – en collaboration avec
Virginie Neufville
Benjamin Wood, Le
Complexe d’Eden Bellwether (The Bellwether Revivals), traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Renaud
Morin, éd. Zulma, 28 août 2014, 512 pages.
Le roman de campus (campus novel) est un genre littéraire majoritairement anglo-saxon auxquels les auteurs français ne se frottent jamais. Il faut dire
que notre organisation universitaire ne s’y prête pas vraiment : pour
réussir un roman de campus il faut un campus, de préférence prestigieux, et des
étudiants et des professeurs vivant en vase clos. Les sorbonnards sont dans
Paris, pas sur un campus. Les intrigues de ces romans tournent en général autour
de quelques thèmes définis : le prof-gourou, l’étudiant pauvre qui ne se
sent pas à sa place, la dénonciation des mœurs universitaires et la rivalité
entre chercheurs, l’énigme policière, l’étudiant d’exception qui exerce
perversement son pouvoir de fascination. Je citerais en vrac et en désordre,
parmi mes lectures marquantes de ce genre : Possession d’A.S. Byatt, Los
crímenes de Oxford de Guillermo Martínez, Le Roman du mariage de Jeffrey Eugenides, les enquêtes de
l’inspecteur Morse de Colin Dexter, et bien sûr l’inégalable Maître des illusions de Donna Tartt. Benjamin
Wood, avec son roman Le Complexe d’Eden
Bellwether, se coule parfaitement dans le moule de ce genre littéraire. Et
avec quel talent !
Oscar est aide-soignant
dans une maison de retraite proche de Cambridge. Il vient d’un milieu modeste
et a refusé de faire des études, préférant prendre son indépendance. Un soir
d’octobre 2002, tandis qu’il rentre chez lui après une journée fatigante et
désespérante, il est séduit – envoûté – par le « vrombissement » d’un
orgue et la pureté d’un chœur s’échappant de la chapelle du King’s college. Il entre. Une jeune
fille attire son attention :
« Les seuls moments où la jeune fille blonde
se tenait tranquille, c’était quand le chœur chantait. Sa poitrine se
soulevait, ses lèvres frémissaient. Elle paraissait intimidée par la tapisserie
des voix, la clarté du son, les harmonies qui enflaient et inondaient l’espace
béant au-dessus de leurs têtes. Oscar la vit battre la mesure sur son genou
jusqu’à l’Amen final. Le chœur s’assit, et le silence, tel un parachute déployé,
descendit dans la chapelle » (p.16).
 |
| Orgue de la chapelle du King's college - Cambridge |
La jeune fille blonde se
nomme Iris Bellwether, et l’organiste est son frère Eden. Ils sont tous deux
étudiants à Cambridge, et Oscar va intégrer leur petit groupe composé, outre le
frère et la sœur Bellwether, de Jane la petite amie d’Eden, de l’Allemand
Marcus et de l’Américain Yin. Oscar est amoureux d’Iris, Iris est amoureuse
d’Oscar. Tout pourrait aller très bien, malgré les différences sociales. Mais… Lors
d’une soirée, et comme pour intégrer le groupe, Oscar est soumis à une sorte
d’initiation : hypnotisé par Eden, il subit une séance de torture. Lorsqu’il
apprend ce qu’on lui a fait – et dont il ne lui reste aucun souvenir ni aucune
trace physique – il prend conscience de la véritable personnalité d’Eden
Bellwether. Ce jeune homme est un être manipulateur, d’une intelligence et d’un
charisme démoniaques. Eden pense que la musique peut influer sur les âmes et
les corps. Influer à un point tel qu’elle peut soigner et guérir. Il ne s’agit
pas de la simple musicothérapie telle qu’elle est exercée parfois dans les
hôpitaux pour soulager. Non. Eden Bellwether, s’appuyant sur les écrits du
philosophe Descartes et du musicien allemand Johann Mattheson, est persuadé
qu’il possède un pouvoir de thaumaturge – même si le mot n’est jamais prononcé
dans le roman – grâce à la musique qu’il compose à l’orgue. Sa sœur Iris, violoncelliste,
et ses amis Jane, Marcus et Yin, chanteurs, font aussi partie de sa partition.
Il les fascine, les subjugue, les enrôle.
Le roman est diaboliquement
construit autour des univers différents d’Oscar et des Bellwether. La maison de
retraite d’un côté, l’université de Cambridge et une famille plus qu’aisée de
l’autre. Benjamin Wood réunit ces deux univers incompatibles par le biais d’un
pensionnaire de la maison de retraite où travaille Oscar. La résurgence
d’anciennes amours homosexuelles mettront sur la route d’Eden, l’organiste et
compositeur si sûr de lui, un spécialiste des troubles de la personnalité. À
moins qu’Eden, manipulateur de fond et de forme, n’ait fomenté la rencontre et
l’affrontement…
On ne peut en dire plus sur
le déroulement du roman, ce serait gâter le plaisir du lecteur. Disons seulement
que le drame, annoncé dès les premières pages, dans le « prélude »,
semblait inéluctable. Par-delà la maîtrise de l’intrigue – qui tourne autour de
la personnalité d’Eden ; est-il un malade ou un génie ? – Benjamin
Wood parvient à cerner au plus près les individualités de ses personnages.
Ainsi Iris, sceptique puis convaincue, puis sceptique à nouveau à propos des
dons de son frère ; ainsi le vieux M. Paulsen et son ancien disciple qui
se retrouvent au seuil de la mort ; ainsi Jane, la petite amie d’Eden, qui
joue les écervelées, cachant son intelligence, et sachant toujours faire
rebondir les conversations pénibles par un trait d’esprit à ses dépens… L’aveuglement
parental, la préférence pour l’un ou l’autre de ses enfants, la culpabilité que
l’on peut éprouver à renier sa famille, ou simplement à la délaisser… L’amour
enfin accepté et reconnu, se voulant libéré de toute influence (1)… La mort et
le fol espoir d’y échapper, ou d’en différer la venue (2)… Le deuil et
l’acceptation du deuil… Le non-renoncement à son art – il faut
« voir » et « entendre » Iris, à son violoncelle,
transgresser la partition de son frère et faire sonner son instrument selon son
cœur et sa respiration propre… Avec Le
Complexe d’Eden Bellwether, Benjamin Wood, jeune auteur de 33 ans, signe
ici un premier roman très abouti, sensible et machiavélique.
Notes
(1) Oscar, à Iris :
« J’aimerais simplement t’avoir sans l’avoir, lui [= Eden]. Tu n’es pas la
même quand il est dans les parages » (p.259).
(2) « J’ignore ce
qu’Oscar t’a dit de mon nouveau livre », dit Crest, le spécialiste des
troubles de la personnalité souffrant d’une tumeur au cerveau, à Iris
Bellwether. « Ma théorie est que l’espoir est une forme de folie. Une
folie bénigne, certes, mais une folie tout de même. En tant que superstition
irrationnelle, miroirs brisés et compagnie, l’espoir ne se fonde sur aucune
espèce de logique, ce n’est qu’un optimisme débridé dont le seul fondement est
la foi en des phénomènes qui échappent à notre contrôle » (p. 235).
*
Lire l’article de Virginie Neufville sur le roman